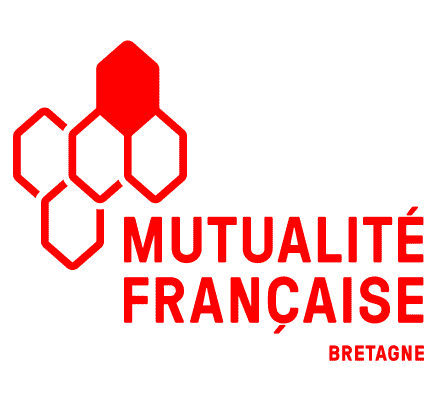Le Mouvement Associatif de Bretagne tire la sonnette d’alarme
- Interview
- 4 novembre 2025
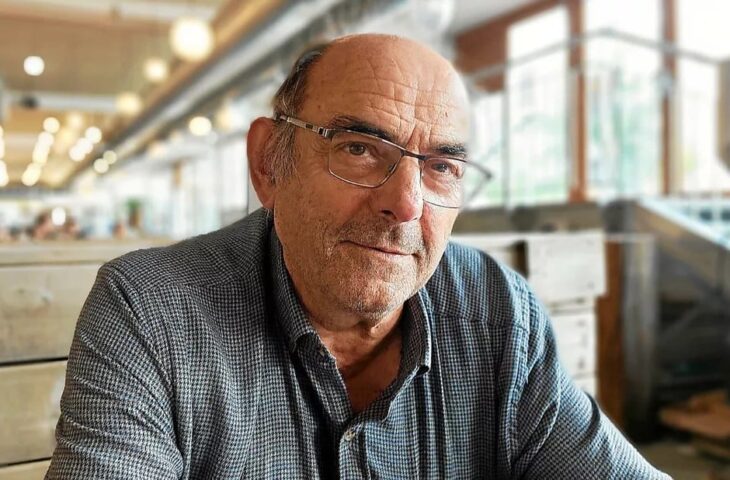
Vice-président du Mouvement Associatif national et président du Mouvement Associatif de Bretagne depuis quatre ans, Thierry Abalea est engagé dans la vie associative depuis toujours, comme salarié ou comme bénévole. À l’aube de nouvelles coupes budgétaires, il revient avec nous sur les difficultés traversées par le monde associatif ces deux dernières années et celles à venir. Rencontre.
Pouvez-vous vous présenter et nous rappeler ce qu’est le Mouvement Associatif Breton ?
Le Mouvement Associatif existe aujourd’hui dans toutes les régions de France (également en outre-mer), et il existe également un Mouvement Associatif national.
Il est constitué de 22 coordinations régionales sectorielles classées parmi ces 10 thématiques :
- Jeunesse et éducation populaire
- Environnement
- Égalité & défense des droits humains
- Consommation & prévention
- Tourisme
- Sports
- Sanitaire, social & médico-social
- Familles
- Culture et médias
- Collège territorial
L’objectif premier du Mouvement Associatif Bretagne est de représenter les intérêts du monde associatif, dans sa diversité et sa totalité, auprès des pouvoirs publics.
Il s’agit également de travailler ensemble sur des questions communes au monde associatif : le bénévolat, le caractère non-lucratif, les incidences fiscales, l’emploi, les relations avec les pouvoirs publics, les modèles économiques, etc.
Quelle place les associations occupent-elles aujourd’hui dans le paysage économique et plus largement dans la société bretonne ?
Sur le plan national, nous avons pu le voir notamment avec la mobilisation du 11 octobre, les associations tiennent une place centrale dans la vie sociale des citoyens. Il s’agit de prendre en considération des besoins sociaux mal couverts ou non couverts, et donc de défricher les besoins nouveaux de notre société, notamment sur les questions de transition écologique, d’égalité femmes-hommes, mais aussi de santé. La place du monde associatif, c’est d’être ni l’État, ni l’intérêt marchand, c’est ce qu’on appelle le tiers secteur, qui est la place du citoyen dans la construction et la consolidation d’un modèle démocratique. Les associations ont donc un rôle éminemment politique qui est de faire vivre la démocratie au plus près des citoyens.
Concrètement, cela se traduit par certains chiffres :
- Près de 2 millions d’associations en France et 80 000 en Bretagne,
- 1,5 à 2 millions de bénévoles en France et 700 000 en Bretagne.
Les études montrent qu’à peu près 1 Breton sur 3 est engagé bénévolement dans une association, ce qui est à peu près la même chose en France. Le monde associatif mobilise donc la plupart des Français, et aucun Français n’échappe, à un moment de sa vie, aux services rendus par le monde associatif.
- 100 000 emplois en Bretagne, soit 10 % de l’emploi privé, est issu du monde associatif. Sur le monde de la santé privé en Bretagne, le monde associatif représente 6 % de l’emploi.
- 140 milliards d’euros, c’est le poids du monde associatif en France aujourd’hui. La part d’aide publique est de l’ordre de 35 milliards. Cela souligne que pour 1 € investi dans le monde associatif, l’Etat génère entre 3 et 4 euros de richesses : tout euro mis dans le monde associatif génère, de manière exponentielle, des richesses sociales et financières bien plus importantes. La disparition d’associations représenterait donc un coût humain et financier bien plus important que ce que cela ne coûte en réalité en subvention.
Selon vous, qu’est-ce qui caractérise les associations bretonnes ?
À la demande du Conseil Régional de Bretagne, l’IFOP et Recherches et Solidarités ont réalisé, il y a six mois, une étude sur le monde associatif breton.
Ce qui est intéressant, c’est que nous avions le sentiment, les uns et les autres, qu’il y avait une singularité associative en Bretagne, sans parvenir à la qualifier.
Cette étude nous a permis de confirmer notre pressentiment ; en Bretagne, il n’y a pas forcément de densité associative plus importante qu’ailleurs, mais il y a un maillage du territoire associatif très développé, il n’y a pas de territoire oublié.
Également, cela nous a permis de constater qu’en Bretagne, les jeunes s’engagent plus qu’ailleurs dans le monde associatif. Et c’est globalement vrai pour l’ensemble des Bretons quel que soit leur âge : jeunes mais aussi nouveaux retraités (60-70 ans). Le retour ou l’arrivée de retraités qui viennent en Bretagne après avoir eu une activité professionnelle ailleurs, contribue à cette vitalité.
Troisième élément intéressant en Bretagne : il y a plus de mixité sociale chez les bénévoles et les dirigeants associatifs qu’ailleurs. En effet, les inégalités sociales sont également à l’œuvre dans le milieu associatif : plus on a un niveau de diplôme élevé, plus on va être amené à prendre des responsabilités dans le monde associatif. Et donc, à contrario, moins on a de diplômes, moins on est présent dans les instances de responsabilité. Et donc, cela est vrai en Bretagne, mais moins qu’ailleurs. Les milieux faiblement diplômés accèdent, eux aussi, à des postes à responsabilité dans le monde associatif.
Les associations sont mises à rude épreuve avec les coupes budgétaires prévues dans le cadre du budget 2026 par le Gouvernement, comment cela va-t-il se traduire pour les associations bretonnes ?
Cela se traduit déjà. Nous avons déjà subi des coupes budgétaires en 2025, d’où la mobilisation du 11 octobre. Les difficultés budgétaires du monde associatif ne sont pas nouvelles, mais nous arrivons à un stade où nous ne pouvons pas aller plus loin.
Le caractère non-lucratif du champ associatif fait que les associations ont globalement une culture où elles dégagent assez peu d’excédents dans leur budget et n’ont pas vocation à faire de bénéfices. Lorsqu’elles en font, elles le réinvestissent dans le projet social de leur association. Traditionnellement, les associations ont donc peu de marges financières. Et lorsque c’est le cas, elles sont interpellées par les pouvoirs publics, qui parfois refusent leur demande de subvention. Cette culture de la non-lucrativité, mal comprise, a eu pour effet pendant très longtemps, que les associations visaient un équilibre financier sans aucune marge financière. Le moindre incident a donc des conséquences dramatiques.
Le Covid a également très durement touché le monde associatif, du côté financier, mais aussi du côté de l’engagement (moins de bénévoles, perte d’adhérents, etc.).
La crise inflationniste avec la montée des charges et des biens de consommation, a perturbé grandement la construction des budgets associatifs, et cela, sans aide particulière en provenance de l’État.
Aujourd’hui, la question de la dette publique, qu’il nous faut collectivement assumer, fait qu’on assiste depuis deux ans à des coupes budgétaires importantes dans le milieu associatif.
Le Mouvement Associatif et le Réseau National des Maisons des Associations ont fait une enquête sur la situation financière des associations il y a quelques mois, qui vient d’être renouvelée. Nous constatons que certaines associations ont disparu (c’est la première fois qu’on observe un taux de dépôt de bilan d’associations aussi important), d’autres ont réduit grandement leur activité. Pour les associations employeuses, on assiste à un plan social majeur, de plusieurs dizaines de milliers d’emploi : ce sont 80 000 emplois menacés en France dans le champ associatif en 2025-2026, selon l’enquête.
L’autre illustration de ces difficultés, c’est que 1/3 des associations n’a pas de visibilité de trésorerie au-delà de trois mois, et donc s’interroge sur ses conditions de survie dans les trois prochains mois. Cela se traduit par des plans de licenciement, des emplois non renouvelés, mais également des départs volontaires de salariés qui s’inquiètent de la pérennité de leur poste. Cela questionne l’attractivité du secteur associatif.
Ce plan social est assez invisibilisé, car il se fait sur l’ensemble du territoire breton et non sur un seul site, comme peuvent le faire de grandes entreprises du secteur privé. Il faut également savoir que nombre d’associations sont constituées de moins de trois salarié.e.s, donc effectivement quand un.e d’entre eux/elles s’en va, c’est toute la solidité associative qui est fragilisée.
Dernier effet de tout cela, c’est un découragement manifeste des bénévoles dirigeants, qui n’en peuvent plus de devoir gérer toutes ces difficultés pour lesquelles ils ne se sont pas engagés. Il n’y a pas de crise du bénévolat ou de l’engagement, mais il y a une vraie crise du bénévole dirigeant (président, trésorier).
Comment le mouvement associatif de Bretagne a-t-il prévu de réagir face à ces annonces ?
Par définition, le Mouvement Associatif réagit en permanence puisque c’est sa première fonction.
Pour autant, nous avons un peu innové dans le monde associatif, avec cette mobilisation du 11 octobre qui est un peu inédite. Les associations, avec leurs bénévoles et salariés, se sont réunies dans l’espace public pour alerter sur les limites de ces coupes budgétaires. L’ensemble du monde associatif s’est emparé de cette manifestation pour interpeller les pouvoirs publics : 350 manifestations en France, une trentaine répartie sur l’ensemble du territoire breton.
Nous avons également adressé un courrier à l’ensemble des parlementaires de Bretagne – et nos collègues des autres mouvements associatifs régionaux font la même chose avec leurs parlementaires – pour les interpeller dans les débats budgétaires sur le PLF et le PLFSS, parce-que de nombreuses associations, particulièrement dans le secteur du médico-social, sont évidemment impactées par le PLFSS. Nous avons un certain nombre de propositions d’amendements, pour que les parlementaires les relaient lors des discussions budgétaires. Notre discours est de leur demander d’arrêter l’hémorragie.
Les associations jouent un rôle indéniable pour l’accès à la santé, quels seraient les conséquences de ces coupes budgétaires sur ce secteur en particulier ?
Nos amis de l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales) et de la FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité), nous disent que certains établissements du champ médico-social non-lucratif, s’interrogent sur leur existence dans les trois mois qui viennent. La non-compensation des mesures du SEGUR dans le champ du médico-social a de lourdes conséquences dans le champ associatif comme dans le monde mutualiste. D’autres acteurs comme le Planning familial Ille-et-Vilaine, ont fait le constat que sans restrictions importantes chez eux en 2026, un dépôt de bilan serait envisagé. Pour les mêmes raisons de non-compensation des mesures du SEGUR, les CIDFF (Centre d’informations des droits des femmes et de la famille) ont licencié du personnel, renoncé à des permanences d’accueil des femmes victimes de violences, dans les quatre départements bretons, et s’interrogent encore sur leur existence en 2026. Il y a donc des personnes qui ne seront plus prises en charge.
Par ailleurs, dans le secteur de la santé, les associations de patients et de leur famille jouent un rôle crucial dans la prise en charge des malades et pour soutenir la recherche médicale. Sans moyens, la qualité des soins s’en trouvera affectée.
De manière générale, la dégradation du monde associatif et du monde de l’ESS va contribuer à aggraver la situation socio-économique actuelle. Un territoire où il n’y a plus d’associations est un territoire dans lequel il n’y a plus d’interactions et de vie sociale. Et un territoire où il n’y a plus de vie sociale n’est pas un territoire propice au développement d’activités économiques conventionnelles marchandes. Une entreprise qui veut s’insérer quelque-part, a besoin d’un territoire dans lequel il y a une vie sociale dynamique, active, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de ses salariés.
-
Mut’Info Bretagne #38
- Édito
- 19 janvier 2026
-
Splann ! : média indépendant et breton qui lutte contre la désinformation
- Interview
- 9 décembre 2025
-
Mut’Info Bretagne #36
- Édito
- 4 novembre 2025