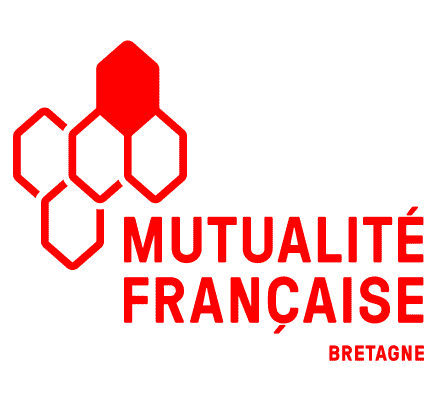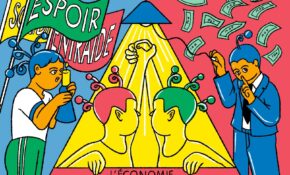Enquête : « Dans la tête des femmes : préoccupations, attentes et rapport à la politique et au féminisme »
- Interview
- 13 mars 2025

Comment analyser le vote des femmes à l’aune des élections européennes et législatives de juin et juillet derniers ? Sur quelles préoccupations repose leur vote ? Sept ans après #MeToo, quelle est la perception de l’opinion publique en matière d’égalité femmes-hommes et leur rapport au féminisme ? Amandine Clavaud, directrice de l’Observatoire égalité femmes-hommes de la Fondation Jean Jaurès a analysé avec Laurence Rossignol, sénatrice, présidente de l’Assemblée des femmes et ancienne ministre des Droits des femmes, les résultats de l’enquête réalisée par Ipsos.
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur la Fondation Jean Jaurès et ses missions ?
Amandine Clavaud : je suis co-directrice du secteur « études et recherches » au sein de la Fondation Jean Jaurès, j’y dirige également l’observatoire de l’égalité femmes-hommes. Je suis aussi l’autrice d’un essai Droits des femmes : le grand recul, sorti en 2023, aux éditions de l’Aube. La Fondation Jean Jaurès est une fondation politique, reconnue d’utilité publique, créée en 1992 par Pierre Mauroy. Nous travaillons sur l’ensemble des politiques publiques à travers des publications et des événements. Nous avons vocation à réunir des responsables politiques et institutionnel·le·s, des universitaires, des expert·e·s, des représentant·e·s de la société civile, des syndicats…avec un double objectif :
- Contribuer au débat public pour nourrir les citoyen·ne·s
- Porter des recommandations auprès des pouvoirs publics
Vous avez réalisé une étude avec Laurence Rossignol « Dans la tête des femmes : préoccupations, attentes et rapport à la politique et au féminisme ». Pourquoi ce sujet et quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés ?
La Fondation Jean Jaurès est engagée depuis sa création dans la défense des droits des femmes. On y travaille autour de 4 thématiques : la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR), l’égalité professionnelle, la représentation des femmes dans les instances de décision. C’est dans ce cadre, et avec l’Assemblée des femmes que Laurence Rossignol préside, que nous avons décidé de mener une enquête dans la foulée des élections européennes et législatives, en juin et juillet dernier, afin d’analyser et de comprendre les attentes et les préoccupations de l’opinion publique vis-à-vis de la politique, de l’égalité femmes-hommes en tant que politique publique, et leur rapport au féminisme.
Quels sont les grands enseignements de l’enquête ? Vous-ont-ils surpris ?
Cette enquête a suscité chez nous de l’optimisme et de l’inquiétude, deux dimensions qui montrent bien l’ambivalence de l’opinion publique en ce qui concerne l’égalité femmes-hommes et son rapport au féminisme.
En effet, les résultats de l’enquête montrent que l’adhésion au féminisme est désormais majoritaire dans l’opinion, chez les femmes comme chez les hommes. Mais on observe des différences sérieuses, voire préoccupantes, entre générations, et entre les femmes et les hommes d’une même génération. Un autre enseignement : la prise en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles demeure une demande importante dans l’ensemble de l’opinion publique. Mais la traduction politique se fait encore attendre et l’incarnation semble manquer, comme le déplore le panel que nous avons interrogé. Enfin, l’enquête montre que les questions économiques et sociales sont les premières préoccupations des femmes qui attendent des réponses des pouvoirs publics pour remédier aux inégalités professionnelles qu’elles subissent et qui dégradent leurs conditions de vie.
Votre étude met en effet en évidence des premières préoccupations différentes chez les femmes et chez les hommes, notamment les questions de santé. Identifiez-vous des facteurs qui expliqueraient que les femmes y sont plus sensibles ? Quelles réponses pourraient être apportées pour répondre à ces attentes ?
L’enquête révèle que, après le pouvoir d’achat, le système de santé constitue la deuxième préoccupation majeure pour les femmes – pour 35 % d’entre elles, soit six points de plus que pour les hommes. Cet écart significatif souligne que les femmes sont particulièrement affectées par les défaillances de notre système de santé. Elles sont notamment les premières à subir des ruptures dans la continuité des soins.
C’est aussi parce que la santé est une préoccupation constante tout au long de la vie des femmes. Des premières règles, jusqu’à la prise en charge de la contraception, en passant par l’accès aux soins gynécologiques et à la maternité pour une partie d’entre elles, l’accès à l’IVG, la ménopause…autant d’étapes spécifiques aux femmes. Elles sont aussi en première ligne sur la question du vieillissement et de la dépendance, notamment parce que dans notre pays, ce sont encore très majoritairement les femmes qui sont aidantes. Enfin, ce sont aussi celles qui ont le plus souvent la charge des soins dans leur famille et de leur entourage (prises de rendez-vous médicaux, des médicaments à la pharmacie…). Elles sont ainsi les premières concernées face aux défaillances d’accès dans les services publics. C’est pourquoi les femmes sont majoritaires à demander un renforcement des structures de santé dans les petites villes, même si cela conduit à une hausse d’impôt.
De manière générale, l’étude souligne qu’il y a un enjeu à investir dans le service public de santé. Si les femmes y sont plus sensibles, c’est une demande partagée par l’ensemble de l’opinion publique, tous territoires confondus, que ce soit en grande métropole ou en zone rurale isolée : il y a un consensus très fort pour un renforcement du service de santé public.
L’adhésion au féminisme est désormais majoritaire, mais vous soulignez des différences marquées entre générations, notamment une fracture préoccupante entre jeunes femmes et jeunes hommes. Comment expliquez-vous cette tendance et quels en sont les enjeux ?
L’enquête met en évidence un attachement très fort des jeunes femmes de moins de 35 ans aux questions féministes. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est notamment une préoccupation majeure pour elles. 16 % des jeunes femmes se disent fortement engagées dans cette cause, soit 8 points de plus que la moyenne des Français·e·s. De même, 75 % des femmes de 18 à 24 ans considèrent la lutte contre les discriminations comme une priorité, un chiffre supérieur de 11 points à la moyenne nationale.
Ces résultats s’expliquent en partie par l’évolution du contexte sociétal. La génération actuelle a grandi dans le sillage du mouvement #MeToo, ce qui a renforcé la sensibilisation aux questions d’égalité et de lutte contre les violences. Cependant, bien que cette génération soit globalement plus sensibilisée à ces sujets, tout comme à la lutte contre le réchauffement climatique, elle n’est pas homogène. Ce que l’on observe, c’est un « modern gender gap » : dans les démocraties occidentales, une tendance croissante des jeunes femmes à voter pour des partis progressistes se dessine. En revanche, du côté des jeunes hommes, on observe une véritable dichotomie. Si une partie d’entre eux se positionne comme des alliés du féminisme (15,5 % d’entre eux répondant « Oui, tout à fait » à la question « Diriez-vous de vous-même que vous êtes féministe ? », un chiffre supérieur à la moyenne masculine), une autre partie exprime un rejet total du féminisme (à 15%). Cette polarisation s’accentue avec la montée en puissance de la pensée masculiniste, largement diffusée par les réseaux sociaux, où l’on retrouve des discours valorisant la virilité, la puissance et la domination masculine. Cette tendance rejoint les conclusions d’autres études, comme le baromètre sur l’état du sexisme du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est préoccupante, car elle se reflète également dans certaines dynamiques électorales récentes, avec un clivage générationnel et genré de plus en plus marqué. Le défi est de mieux prendre en compte cette surexposition dans les réseaux sociaux et d’y répondre par des actions de sensibilisation adaptées.
L’enquête montre aussi combien la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité largement partagée, néanmoins sa traduction politique semble insuffisante. Quelles seraient, selon vous, les mesures qui devraient être mises en œuvre pour répondre à cette attente ?
Les femmes et les hommes s’accordent à dire que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) doit être la priorité du mouvement féministe. La lutte contre les inégalités professionnelles arrive en deuxième position, avec 37 % des femmes la considérant comme essentielle, soit 6 points de plus que les hommes. Cette préoccupation est étroitement liée à l’importance du pouvoir d’achat pour les femmes.
Il existe donc un consensus fort au sein de l’opinion publique pour s’attaquer aux violences sexistes et sexuelles. Dans le contexte budgétaire actuel, il est crucial de faire de cette lutte une véritable priorité en matière de financements pour répondre aux besoins, et accompagner les femmes victimes de violences masculines. La Fondation des Femmes avait estimé qu’il faudrait entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros pour lutter efficacement contre ces violences. Nous sommes encore loin du compte.
Dans un contexte international marqué par un backlash (recul des droits des femmes), il est essentiel de se demander comment agir concrètement. Sur le terrain, le travail des associations est crucial et déterminant. Enfin, un accompagnement renforcé des victimes est nécessaire, avec une meilleure prise en charge par les structures spécialisées et une augmentation des moyens pour les associations de terrain qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les VSS.
Un autre levier essentiel est l’éducation à la vie affective et sexuelle pour lutter contre les stéréotypes, et prévenir les violences de genre. La loi de 2001 prévoit son enseignement, mais elle est rarement appliquée de manière effective. Il est indispensable de renforcer cette éducation dès le plus jeune âge. L’école doit être un lieu d’apprentissage et de protection, notamment parce que la majorité des violences ont lieu dans la sphère familiale. Or, certains opposants à cette éducation estiment que ces sujets relèvent de la responsabilité parentale, ce qui peut être problématique lorsque des violences existent au sein du foyer.
Enfin, vous avez participé au lancement de la commission MutElles en Bretagne, qui vise à renforcer notre engagement et nos actions sur la place et la défense des droits des femmes en notre région. Selon vous, quel rôle la Mutualité Française et les mutuelles peuvent-elles jouer aujourd’hui pour faire avancer les droits des femmes et lutter contre leur recul ?
Je souhaite saluer l’initiative de lancer une commission MutElles en Bretagne pour renforcer les actions de la Mutualité Française en matière d’égalité femmes-hommes dans la région. C’est inspirant et utile. Je suis convaincue que chaque organisation a une responsabilité. Une entreprise, en tant que mini-société, doit prendre en charge la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) et contre les inégalités femmes-hommes. Cela inclut l’accompagnement des salarié·e·s ainsi que la définition d’objectifs à poursuivre au sein de l’entreprise.
La Mutualité, et les mutuelles particulièrement, ont un rôle crucial à jouer dans la défense des droits des femmes. Leur rôle de sensibilisation et d’accompagnement est non négligeable. Surtout, elles peuvent porter une approche genrée des politiques de santé. Car les femmes ont des besoins spécifiques. Ces questions traversent la vie des femmes tout au long de leur parcours. Par exemple, des pathologies – comme l’endométriose – étaient mal prises en charge car sujettes à des stéréotypes de genre par les professionnel·le·s de santé ; les aidantes subissent un impact significatif sur leur vie personnelle et professionnelle, ainsi que sur leur santé mentale. Sans une approche genrée, nous passons à côté de la sensibilisation, de la prévention, et même des recherches médicales, qui ne prennent souvent pas en compte les spécificités du corps féminin dans les tests. Les mutuelles peuvent porter ces sujets et agir auprès des pouvoirs publics.
Enfin, dans le contexte international, notamment avec l’administration Trump, nous avons vu des conséquences dramatiques en termes de données publiques et de recherches médicales. Les termes comme « femmes », « filles », « LGBT », et « genre » ont été supprimés des documents officiels, entraînant la disparition de données cruciales. Face à cette situation, la diplomatie féministe et les financements consacrés aux associations féministes seront fondamentaux pour s’opposer à ces vents contraires et promouvoir ainsi une véritable égalité. La Mutualité peut, dans ce cadre, appuyer les initiatives en faveur de la défense des droits des femmes.